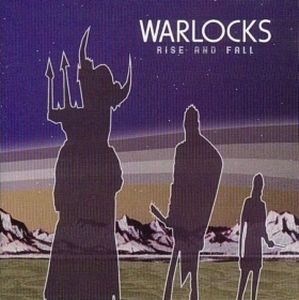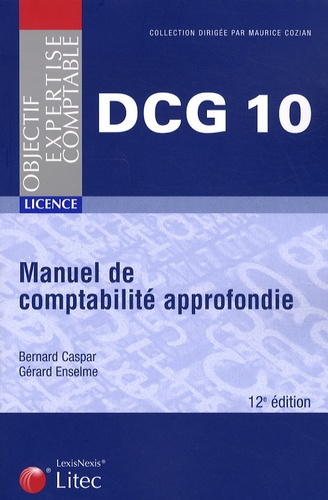Comme si l’on était tous parfaits. Comme si nous étions tous autre chose que des Karl Lagerfeld et des Lady Gaga de salon. On a tous déjà eu ce sentiment, d’être fondamentalement mauvais.
Oui, vous vous souvenez, au collège et au lycée, ce prof qui pensait que vous n’obtiendrez jamais la moyenne demandée en math…
Et bien des fois, la nature humaine se révolte, et l'on travaille d'arrachepied pour leur prouver à tous qu’ils avaient tort, et que pour une fois, une seule et unique fois que l’on valait mieux que ça.On décrochait un onze sur vingt (ou mieux pour les plus motivés) et on avait, par ces quelques traits tracés sur une copie littéralement craché au visage du responsable de nos souffrances.
Si vous avez déjà ressenti ce genre de sentiment, vous partagerez ma passion pour les petits, les habituellement médiocres qui ont sué sang et eau une seule fois pour toute. Le tout pour une petite place au top 50 et voir leurs piles de 45 Tours fraichement pressés fondre comme neige au soleil, avant de disparaitre définitivement dans l’anonymat.
Oui ces gens pour qui j’éprouve une passion particulière sont les « One Hit Wonders » ou «merveilles d’un titre» en français.
Ils fourmillent dans de magnifiques compilations qui comptent des quantités insolentes de gemmes et de pépites cachées.
Les compilations
Nuggets,
Children of Nuggets ou alors, la quantité chavirante des
Pebbles disponibles sur Internet via d’excellents labels pourront vous en convaincre.
Mais vous n’aurez pas toujours besoin de courir après ces merveilles publiées avec amour sur des labels indépendants.
Car parfois des miracles ont lieu, car oui, ce genre d’accidents industriels musicaux arrivent.
Il arrive en effet que de temps en temps des Majors désireuses de rentabiliser leur fond de catalogue pressent les meilleurs hits et faces B de leurs gloires inconnues en petites quantités.
Elles empaquètent le tout sous une Jacquette aussi mensongère que putassière et cèdent cette compilation a bas prix afin de faire vite partir les stocks.
L’affaire est vite oubliée par les protagonistes eux mêmes, l’actualité étant rapidement accaparée par la sortie d’une merde grand public infâme, mais un peu plus rentable pour la boite.
Ces merveilles de bacs à solde oubliées comblent maintenant les mélomanes que nous sommes, bénissant les directeurs artistiques ou les chefs de produits de ces grandes maisons de disque pour avoir été si connaisseurs, ou inconscients. C’est le cas pour la bien nommée « Burning Sounds! 20 power pop killer cuts ! »
On ne rentrera pas ici dans les détails biographiques des divers groupes venus de tous horizons Garage, Punk, Rock et Pop présents sur cette compile.
Cependant le fait marquant pour l’auditeur est qu’un un trait commun les unit tous : l’amour d’une musique aussi flamboyante que rythmée, donnant aux prestations des diverses formations une touchante unité.
Dès le titre d'entrée, on aura compris le ton aigre doux de la compilation avec "Shake Some Action" un titre tardif des héros Californiens du Rock Garage à savoir les Flamin' Groovies. Cette longue complainte posée sur des entrelacs amers de guitares tristes, et déjà nostalgiques d'un temps qu'elles ont crût à peine voire passer.
Le tube suivant est une cathédrale de pop rock Kitsch totalement improbable portant le nom proverbial "Overnight Sensation (Hit Record)" implorant les dieux du succès dans une magnifique supplique. Imaginez vous mélanger du Elvis Presley (pour la voix) , du Beach Boys (pour les harmonies vocales), du Elton John (pour le piano) et du Queen (pour la prestance et les guitares) le tout dans un élan glam anglais. Le pont proprement hallucinant à 3'00 suffira à vous convaincre du génie ignoré des Raspberries.
L'étrange patchwork que constitue ce disque continue avec un groupe de Pub Rock, Brinsley Schwarz, notoirement connu pour avoir pillé Crosby, Stills, Nash and Young et Grateful Dead.
Les traces de ses influences dans "The Ugly Things" ne sont pas si évidentes du tout, et la tristesse et la mélancolie du groupe n'ont pas vieilli. La chanson suivante "SubRosa Subway" dont seul le titre à quelque chose à nous offrir ne restera pas éternellement dans les mémoire, comme le groupe qui l'a produit : Klatuu.
Un groupe qui pour la petite histoire a été vu comme les Beatles de 1976. Une petite hype qui n'a pas empêcher leur unique album d'être un four, la vague pré punk et ses descendant ayant déjà tout emporté.
La création du groupe des anglais The Babys est nettement plus convaincante. "If You've Got The Time" dont les solos ardents sont tout droit tirés des Nuggets et une conviction stupide digne d'un David Lee Roth gonflé aux stéroïdes anabolisants emplissant l'effort d'un souffle épique.
Le groupe suivant, et (oui cher lecteur nous n'égrainons ici qu'une simple liste de damnés du rock, alignés contre le mur de la fatalité attendant le geste du bras d'un commandant de peloton Salvadorien moustachu et suant).
The Boyfriends, au nom aussi magnifiquement cul-cul que bravache produisent quand à eux un surprenant mélange de rock sentimental énergique émaillé de claviers qui pourraient être tout droit sortis des rêves de Steve Nieve. "I'm In Love Today" est un vrai petit bijou de rock pop au sens noble du terme.
"Starry Eyes", une chanson de The Records ressemble fort à un titre de Eddie and the Hot Rods. Encore bourré de références sentimentales amères et tristes, d'histoire de ruptures, de souffrances et de haines passionnées complétement contenues.
Celle ci ayant la simple prétention d'envoyer l'auditeur droit dans le mur et sans autre forme de procès.
La formation suivante, une des plus intéressante de l'album car menée par Glen Matlock, bassiste original des Sex Pistols et fan inconditionnel des Beatles.
Ce dernier ayant été chassé pour cette même raison du groupe qu'il avait contribué pour une grande part à fonder (et oui, c'est sa basse que l'on entend sur plusieurs pistes de "Never Mind the Bollocks"), le tout pour être remplacé par ce petit junkie sans talent ni envergure de Sid Vicious. "Burning Sounds" est le titre éponyme de cette compilation, délivré pas la formation punk que représente les Rich Kids. Tous les ingrédients sont ici au rendez vous: guitares dures et écorchées, riff simpliste batteries sans concessions et morceaux de bravoure (le "Burn !" à 2'08 et le solo qui s'en suit dans un écho de reverb dégoulinante de volts).
Le groupe suivant, The Knack, un groupe de pop de la région de Los Angeles, solidement nourri d'influences sixties (des cœurs de Beatles, et une guitare empruntée aux Kinks aussi mutine que sautillante).
Il ne faut toutefois pas nous laisser berner par la bonhommie de la mélodie et sa livraison emprunte de fraicheur dégourdie. C'est bien de tourments que l'amour dont l'on parle ici (et oui, encore) et de fort belle manière. Je mets personnellement au défi tout mâle hétérosexuel normalement constitué (même votre serviteur) de ne pas se reconnaître dans "That's What The Little Girls Do" et les imprécations empruntes de doutes et d'hésitations adolescentes qu'elle délivre.
La prochaine chanson est une création somme toute originale des Barracudas, ceci pour la simple raison que c'est une des seuls chansons issue de la vague néo Surf des années 80. [What the fuck people?].
Néanmoins on ne pourra que louer cet effort, débutant par une introduction sonore livrant avec un brio dramatique une gravité et une solennité toute maritime (ressac et cris de mouette à l'appui). "His Last Summer" raconte de décès de Ricky, surfeur de son état et frère de vague. Son dernier été, à la recherche de la vague parfaite et du tube de trop. Les refrains entrainants sauront vous convaincre qu'un "surfing suicide" est un concept possible, viable et tout à fait crédible. On passera vite sur "Long Lonely Nights" dont les claviers 80s et les trompettes ont fort vieilli. Le titre suivant étant bien plus intéressant.
Hormis un nom aussi mystérieux qu'improbable The Pale Fountains livre un morceau tout aussi cryptique "Jean's not Happening" un mélange de pop Beatles débuté sur une attaque de guitare tournante destructrice qui meurt dans un dernier relent de Joy Divison fugace. Les violons dramatiques rajoute une touche de beauté tout aussi grandiloquente que solennelle à l'ensemble. Comme un glaviot que l'on aurai craché de Manchester Jusqu'à l'estuaire de la Mersey.
La prochaine chanson "Fell" des Let's active est une ballade sentimentale portée par une voix déçue et plaintive, pleine d'amertume et de regrets. "Vanishing Girls" elle rappellera des souvenirs aux auditeurs émus d'une autre compilation citée precedemment "Children of Nuggets".
Vous pourrez encore me dire que vous en avez marre des noms de groupes proprement mirobolants, mais auvouez tout de même que The Dukes Of Stratosphear" est au moins aussi incroyable que les tressaillements de la basse à 0"15 secondes.
On cessa les pleurnicherie sur un heavy beat de batterie et une batterie turgescente, sans oubliés des paroles stupides d'amertume colérique. Encore le sempiternelle histoire d'un cocu qui souffre "Hard To laugh" est un monument de chœurs collectifs et de cymbale ride. Une belle ironie globale pour un groupe portant le doux nom de Poursuit of happiness, l'histoire no vies en somme, n'est-ce pas ?
On renoue avec la guitare sèche sur "Baby's Coming Back" interprétée par Jellyfish. Autant dire que la chanson est belle malgré des arrangements au sax et au clavier totalement badant (oui, je trouve ce mot tout à fait à propos) et une voix de chanteur à la croisée de celles de Slimmy et Mika des mauvais jours.
Autant le dire, la chanson suivante est un mix de beaucoup de choses, personnellement, je la définis comme une voix de Happy Mondays mixée avec du Beach Boys feats Status Quoi sauce-dance-kitsch-grand-guignolesque. C'était "Everything! (A Song For Dennis Wilson)". Mes amis, je vous le dit de but en blan, la chanson qui suit est juste énorme. L'œuvre d'Orange un combo de punk californien pétris de fuzz et de Beach Boys maniant l'alternance de tempo avec une facilité et une richesse d'arrangements insolents.
Après "Lucy In The Sky" il y aura "Judy Over The Rainbow". Daryll-Ann reprend le flambeau d'une manière tout aussi bouleversante avec des grandes plages de guitare tordue, piquées aux Pixies (caisse claire sèche) et à My Bloody Valentine (guitares velociraptor) mais traitées et arrangées avec un vernis pop-rock faisant la part belle à des solos vibrants et chevrotants.
Le plus beau étant la fin "Good Thing" s'arrète tout net. Quelle audace !
Autant vous prévenir toute suite la piste d'après, Shangri-La vole les premières notes de "A Day In Life". Ne vous méprenez pas, mes amis, ce n'est pas du vol. Ce morceau n'est d'autre qu'un hommage de 7 minutes 30 aux Beatles. Les connaisseurs s'amuseront à reconnaitre des passages de "Hey Jude" et des chœurs et des trompettes de "Magical Mystery Tour".
Decidemment, The Rutles ont été un très bon tribute Band.
Et c’est avec ce fade out sonore interminable que se termine cette compilation.
Oui, la compilation, ce format maudit, celui des inconnus et des sans grades. Méprisé tout entier par certains puristes, car n’étant rien d’autre qu’une liste de courses (comme cette chronique d’ailleurs, pardon à tous).
Avec toute leur humilité ceux-ci nous ont bien montré une chose.
Même englués dans notre quotidien et nos soucis. Il faut essayer de voir plus loin. Comme ils l’ont fait. Dans un élan contemplatif et désintéressé absolu, quitte à se prendre en plein front la vicieuse et ultime balle tirée par la citadelle du destin.
Ces chansons valent le coup, même consommées sur
des grandes plateformes d’écoute de musique en ligne, des mp3 surcompressés pourraves, les uns à la suite des autres, à la manière d’un gros gamin gâté et immonde.
Oui, elles valent sacrément le coup, stéréo et mono, prises studio et lives, originales et reprises confondues, petits labels ou grandes maisons de disque.
Elles nous rappellent tous les jours qu’elles valent le coup de se battre pour elles, de toujours combattre, de ne jamais se rendre. De ne jamais nous rendre.
Ils pourront alors mettre nous dépouilles en tas sur une chariotte, avec celles des derniers forcenés du quotidien, ces derniers navrants résistants de la loose.
Le bourreau ventripotent pourra alors distinguer parmi les loques débraillées et malgré les taches de sang caillé sur nos visages un sourire satisfait. Le plus insupportable de tous à ses yeux : celui que seuls les gens heureux arborent.